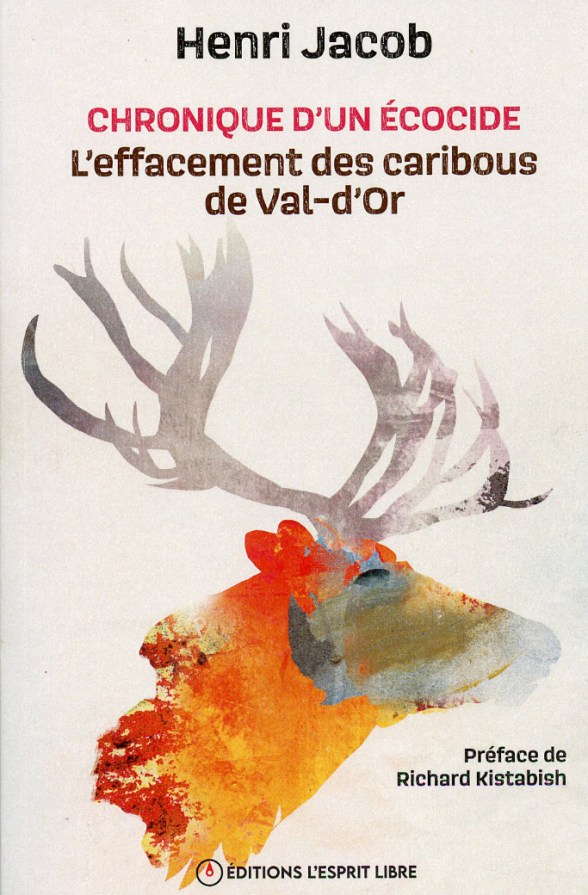Jacques Bérubé
Texte présenté comme travail de session au cours
Histoire des peuples autochtones en Amérique du Nord, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
Pakuashipi, territoire Innu, 1961
Après avoir forcé des mariages entre Innus de Pakuashipi, renommée Saint-Augustin par les colonisateurs français, et d’Unamen Shipu, renommée La Romaine, le curé Alexis Joveneau, un oblat belge installé depuis 1953 sur la Basse-Côte Nord du Québec, orchestre en 1961 la déportation de la petite communauté de Pakuashipi vers Unamen Shipu, sise à 250 kilomètres au sud-ouest, pour rassembler les deux communautés en un seul et même lieu.
La décision de la déportation des Innus — que le gouvernement appelait plutôt « déplacement » ou « relocalisation », le mot déportation étant trop porteur d’un sens historique négatif— était officiellement celle du gouvernement fédéral. Mais il est très probable que l’initiative avait été pensée et proposée au gouvernement par le curé Joveneau, en lui serinant qu’il serait plus facile de gérer un seul endroit — une seule réserve — et en lui faisant miroiter la rationalisation et surtout la rentabilisation des investissements du gouvernement. Et comme les fonctionnaires des « Affaires indiennes » n’étaient évidemment pas sur place, dans ces micro-communautés éloignées des bureaux où ils prenaient les décisions et entérinaient les mesures, Alexis Joveneau disposait donc de grands pouvoirs en tant que délégué de l’État.
Et pour le curé, la possibilité de convertir les Innus à la religion catholique sans avoir à traverser les 250 kilomètres qui séparaient les deux territoires en bateau ou en avion— il n’y avait pas de route — convenait très bien. Et avec ce qui a été révélé quelques années après le décès de ce prêtre abuseur, alcoolique et pédophile, on pourrait aussi croire que la déportation avait l’avantage de lui faciliter l’accès à ses victimes.
« La réunion ou l’assemblée s’est tenue au sous-sol de l’église, c’est le curé qui est venu nous en parler, il n’y avait pas d’agent du gouvernement, (…), c’est le curé qui est venu nous parler de ce déménagement. La raison qu’on nous avait donnée pour déménager, c’était parce qu’on n’était pas une grosse population à Pakua-shipu et le gouvernement voulait faire une réserve seulement. Le chef Tshan Mark (Shinapesht) lui a dit : ‘’On ne peut pas aller s’installer là-bas parce que nos territoires de chasse sont ici, dans l’intérieur des terres, on ne veut pas les quitter’’. Mais il insistait quand même, et en insistant ainsi, il a fini par les convaincre. » (AM, Unamen Shipu, octobre 2011) [1]
La déportation s’effectue donc en août 1961. Pendant 48 heures, 65 Innus de Pakuashipi étaient entassés dans la cale du bateau North Pioneer qui les emportait vers Unamen Shipu. Ils n’ont presque rien mangé et rien bu pendant les deux jours du voyage.
Madeleine Mestenapéo, qui était alors âgée de 18 ans, se rappelle le bruit de la porte qui s’est refermée au-dessus d’elle. Madame Mestenapéo se rappelle encore l’odeur. « Nous étions dans la cale du bateau. Ça puait. Ça sentait le poisson pourri. Les enfants pleuraient et tout le monde était apeuré. Même les chiens étaient dans la cale avec nous. » [2]
Au moment de la déportation, pour s’assurer de conserver une trace de lien spirituel, ils avaient emmené avec eux des poches de terre et de sable de Pakuashipi pour les répandre sur le sol à leur arrivée à Unamen Shipu et en faire la première terre sur laquelle ils posent les pieds.[3]
Pendant deux ans, ces Innus, à qui on avait promis maisons, nourriture et argent, ont vécu sous des tentes ou dans d’autres familles. Maintenus dans un tel état, ils souhaitaient retrouver Pakuashipi, mais le père Joveneau les menaçait s’ils partaient.
Mais en avril 1963, 19 Innus de quatre familles ont bravé les menaces du prêtre et, menées par Shimun Mestenapéo, qui s’était toujours opposé à la déportation, en venant même aux coups avec l’oblat Joveneau, elles ont décidé de revenir avec ce qu’il leur restait de biens dans leur territoire ancestral — Nitassinan — de Pakuashipi. Leur retour, fait à la marche et en canot, a duré un mois. Par la suite, d’autres déportés innus ont suivi l’exemple de ces familles et sont revenus à Pakuashipi, par bateau ou en hydravion.
Aujourd’hui, au sein de la communauté qui compte environ 300 personnes, Shimun Mesteapeo est considéré comme un héros pour le rôle de leader de la résistance face à la déportation qu’il a joué.
« Sans lui, et les autres qui ont marché pour revenir jusqu’ici, il n’y aurait plus d’Innus à Pakuashipi, explique Mika Tenagan, son arrière-petite-fille. Je suis vraiment fière de faire partie d’une communauté et d’une famille qui ont résisté. »[4]
Les mariages inter-communautés orchestrés par Joveneau se rapprochaient des pratiques d’accouplement ayant cours dans l’élevage d’animaux. De même, les conditions dans lesquelles s’est opéré la déportation des Innus de Pakuashipi à Unamen-Shipu étaient pratiquement similaires à celles du transport du bétail. Ces constats nous permettent de dire que, pour Joveneau et pour plusieurs de ses semblables, les Autochtones étaient considérés comme des races inférieures. Et on ne demande pas aux races inférieures la permission pour avaliser les décisions de la gent dominante.
La déportation des Innus de Pakuashipi par des colonisateurs arrivés sur la Basse-Côte Nord tard au XXe siècle représentait une véritable prise de contrôle sur une communauté qui habitait un territoire depuis des siècles. Cette sombre histoire de déportation est en soi un micro-exemple de ce qui s’est fait un peu partout en Amérique du Nord, notamment en Georgie, dont la législature vota en 1827 une loi qui invalidait une constitution et tous les traités signés par les États-Unis avec les Cherokees, qui déclarait que la Georgie était souveraine sur l’ensemble des terres comprises à l’intérieur de ses frontières et qui affirmait qu’elle pouvait prendre possession des terres occupées par les Indiens (sic) à sa guise.[5]
Encore là, on ne parla pas de déportation, mais bien d’émigration et d’échange de réserves de terres. Mais pour les Innus de Pakuashipi, pour les Cherokees et pour les autres nations autochtones qui ont subi le même sort à travers l’histoire, il s’agit bien de déportation, puisque ce mot signifie « dépossession d’un territoire auquel le peuple est attaché », ce qui était bien le cas de ces opérations.
L’assurance de supériorité
L’histoire coloniale d’Amérique du Nord regorge d’exemples de décisions ou d’actions qui portaient atteinte aux droits les plus élémentaires des Premières Nations et qui démontraient non pas le sentiment, mais bien l’assurance de supériorité qu’avaient les colonisateurs blancs sur les Autochtones.
Au Canada, les tristement célèbres déclarations et mesures racistes du premier ministre et responsable des politiques avec les Autochtones, John A. Macdonald [6] et de Duncan Campbell Scott, surintendant du ministère des Affaires indiennes [7] demeurent dans l’histoire comme preuves tangibles de la gouvernance odieuse des Canadiens sur les Premières Nations. Et cette gouvernance s’appuyait tout bonnement sur l’assurance de supériorité qu’avaient les « Blancs sur les sauvages ».
Les Métis étaient tout aussi mal considérés. Dans ses écrits sur les Métis de la Rivière Rouge, le géographe Étienne Rivard cite l’instituteur, avocat et journaliste Auguste-Henri de Trémaudan, natif du Québec et établi au Manitoba, qui, dans son ouvrage de 1936 Histoire de la Nation métisse dans l’Ouest canadien, décrit ainsi le mode de vie métis : « Comme peuple primitif, simple, de bonne foi, placé par la Providence dans une heureuse abondance de biens, et d’ailleurs sans beaucoup d’ambition, les Métis n’avaient presque pas de gouvernement. ».. Rivard cite aussi l’ethnologue français Marcel Giraud, dans Le Métis canadien: son rôle dans l’histoire des provinces de l’Ouest, écrit en 1945 : « Dans l’état actuel des choses, on n’entrevoit guère, pour ces groupes arriérés, de possibilité de relèvement. Leurs habitudes de vie, leurs défauts de caractère sont appelés à se perpétuer dans le milieu physique où ils ont fixé leur résidence et dans l’isolement de fait où ils sont relégués par les blancs, dont les qualités, par suite, leur demeurent étrangères. »[8]
La Loi sur les Indiens; le livre blanc de 1969
La loi sur les Indiens de 1876 est un véritable condensé des politiques colonialistes des gouvernements de l’époque qui établit que les Autochtones n’ont pas tous les mêmes droits que les autres Canadiens et Canadiennes. C’est sous cette loi qu’ont officiellement été créé les « réserves indiennes », dirigées par des conseils de bande, une organisation de gouvernance non traditionnelle, créée par le gouvernement canadien. Presque 150 ans plus tard, de nombreux Autochtones parlent toujours des réserves avec une très compréhensible rage et avec beaucoup d’émotion.
Pour plusieurs, le mot réserve signifie prison, enclos, limitation, contrôle, encadrement, sédentarisation. Le concept même de réserve repose sur une connotation de l’infériorité des peuples autochtones. C’est le conseil de bande, qui relève du gouvernement canadien, qui détermine, selon des règles établies par celui-ci, le droit de résidence des Autochtones sur une partie de territoire, un droit qui, jusqu’en 1973, n’en était pas un de propriété. Le gouvernement était le possédant et les Autochtones qui résidaient dans les réserves étaient des occupants sans propriété, considérés comme mineurs — sans droit de vote — et non comme des adultes.
En 1969, prenant pour prétexte la perception extrêmement négative qu’avaient les Premières Nations de la discriminatoire Loi sur les Indiens et prétendant vouloir instaurer l’égalité entre les Autochtones avec les autres citoyens, le gouvernement de Pierre Elliott Trudeau, avec Jean Chrétien comme ministre des Affaires indiennes et du Nord, tente, avec son livre blanc titré La politique indienne du gouvernement du Canada (Livre Blanc sur la politique indienne), de faire disparaître de la constitution toutes les allusions à l’Indien en révoquant la Loi sur les Indiens. Mais peut-on penser que ce projet de loi était aussi — ou surtout — motivé par le grand rêve de Trudeau : faire du Canada un grand pays homogène et uniforme, habité par une seule et grande nation, de culture canadienne, sans statuts distinctifs, bilingue ad mare usque ad mare. Pas d’Autochtones, pas de Québécois, pas d’Acadiens, pas de fermiers ukrainiens dans l’ouest, rien que des Canadiens. One and a same people in a large and beautiful country — « le plus meilleur pays du monde », dixit son valet Jean Chrétien. Les racines, l’histoire, l’héritage culturel ? On balaie tout cela sous le grand tapis unifolié.
On connaissait déjà le mépris ou même l’animosité de Pierre Elliott Trudeau envers les nationalistes et les indépendantistes du Québec. Mais finalement, ceux-ci n’étaient pas les seuls que Trudeau avait dans sa mire pour nourrir son grand rêve, qu’il était, heureusement, presque le seul à entretenir et qui s’est tranquillement éteint, faute de réalisme et de faisabilité. Il nous est donc permis d’affirmer, près de 60 ans plus tard, que le projet de loi du Livre blanc Trudeau-Chrétien n’était rien de moins qu’un plan d’assimilation dont les résultats auraient signifié un véritable génocide ethnoculturel. Comme l’a écrit le leader politique et auteur cri Harold Cardinal, en réplique au Livre blanc : « La politique présentée en juin 1969 est un programme voilé d’extermination par le biais de l’émancipation ».
Malgré toute son iniquité, la Loi sur les Indiens est la seule qui permet aux Premières Nations d’avoir une reconnaissance en tant que peuple et non pas comme une minorité intégrée au grand tout canadien, et cela peut en partie expliquer la réaction pratiquement unanime de rejet qu’ont eue les Premières Nations devant le projet fédéral de 1969.
La résistance, l’amorce d’un changement
Le retour des Innus d’Unamen-Shipu à Pakuashipi marquait un acte de résistance, voire de rébellion, contre le pouvoir occupant, colonialiste et religieux.
« Le fils de Shimun, Jérôme Mestenapeo, raconte que la marche de retour vers Pakuashipi avait permis un certain affranchissement vis-à-vis de l’autorité du prêtre oblat. À mesure que Shimun se rapprochait de ses terres ancestrales, il renouait avec sa culture, il faisait des cérémonies de purification à chaque campement, des tentes de sudation tous les soirs. Ces activités étaient auparavant interdites par le représentant de la foi catholique. »[9]
Cet acte de résistance et ceux qui ont suivi ailleurs au Québec ont, petit à petit, mené à une reprise en mains et au refus de la dépossession des Premières Nations et ont marqué le pas à la signature d’ententes historiques comme la Convention de la Baie-James et du Nord québécois avec les Cris et les Inuits en 1975, et la Paix des Braves, une entente politique et économique établie entre le gouvernement de Bernard Landry et les Cris, en 2002.
On pourrait aussi penser que les actes de résistance des Premières Nations ont inspiré les populations de villages du Bas-Saint-Laurent qui, en formant au début des années 1970 le mouvement citoyen d’opposition aux fermetures de villages et au déplacement des populations appelé Opération Dignité, allaient mettre fin aux opérations du bien nommé Bureau d’aménagement de l’Est du Québec, le BAEQ, qui avait précédemment fermé 11 villages gaspésiens et qui voulait alors « s’attaquer » au Bas-Saint-Laurent.
Et si… pour conclure
Toutes les évaluations et analyses des colonisateurs sur les façons de vivre des Premières Nations étaient faites à partir de leur propre vision des systèmes humain, social, politique et culturel, avec tout ce que cela entraîne en subjectivité et préjugés.
Et si… Que serait aujourd’hui la société nord-américaine si, plutôt que de la considérer comme primitive et « sauvage », les Européens qui ont colonisé l’Amérique du Nord s’étaient inspiré, ne serait-ce qu’en partie, de la philosophie holistique, humaniste et purement écologiste des Autochtones, qui considèrent les végétaux et les minéraux, comme les humains et les animaux, en tant que parties intégrantes et liées d’un écosystème ? Est-ce qu’empreints de cette façon de concevoir le monde dans lequel nous vivons, nous ne serions pas aujourd’hui plus respectueux de l’environnement, de la nature et des êtres vivants ?
Et si… Permettons-nous donc de rêver… à rebours.
[1] Jérôme, Laurent. KA ATANAKANIHT : la « déportation » des Innus de Pakuashipi (Saint-Augustin). Recherches amérindiennes au Québec, 41 (2-3), 2011.
[2] Lapointe, Magalie, Joveneau et Ottawa avaient un plan machiavélique de déportation, Journal de Montréal, 25 mars 2018
[3] Gill-Couture, Jérôme, Commémorer, guérir, transmettre : la résilience des Innus de Pakuashipi, Radio-Canada.ca, juillet 2023
[4] Gill-Couture, Jérôme, ibid
[5] LARRÉ, Lionel, Histoire de la nation cherokee, Bordeaux : Presses Universitaires de Bordeaux, Collection Parcours Universitaire, 2014
[6] « Lorsque l’école se trouve sur une réserve, l’enfant vit avec ses parents, qui sont des sauvages; il est entouré de sauvages, et bien qu’il puisse apprendre à lire et à écrire, ses habitudes, son développement et sa manière de penser restent indiens. Il est, simplement, un sauvage qui sait lire et écrire. On m’a fortement recommandé, en tant que chef de ce département, de préserver le plus possible les enfants indiens de l’influence parentale, et la seule façon d’y arriver serait de les envoyer dans des écoles de formation industrielles et centralisées, dans lesquelles ils pourront acquérir les habitudes et les modes de pensées des hommes blancs. »
John A. Macdonald, Rapport officiel des débats de la Chambre des Communes
du Dominion du Canada, 9 mai 1883.
[7] « Je veux me débarrasser du problème autochtone. Je ne crois pas, justement, que ce pays doive continuer à protéger une classe de personnes parfaitement capables de se prendre en charge. Voilà tout l’objet de mon propos… Notre objectif est de continuer jusqu’à ce qu’il n’y ait plus
un seul Autochtone au Canada qui n’ait pas été assimilé dans le corps politique,
qu’il n’y ait plus de question autochtone ni de ministère des Affaires indiennes. »
Duncan Campbell Scott, surintendant adjoint du ministère des Affaires indiennes, 1920
En 2015, la Commission de vérité et de réconciliation du Canada déclare que le système de pensionnats autochtones, dont Duncan Campbell Scott a supervisé l’assimilation des enfants autochtones, a mené à un génocide culturel.
[8] Rivard, Étienne, Les Bois-Brûlés et le Canada français : une histoire de famille éclatée. Bulletin d’histoire politique, Vol 24, no 2, 2016
[9] Gill-Couture, Jérôme, op. cit